- Passages là-haut
- Posts
- Passage n°7 ⛰️ Bien-être, sport et résistance
Passage n°7 ⛰️ Bien-être, sport et résistance
Se réapproprier les pratiques de bien-être pour les luttes collectives

Hors délai sur la section 2. La douche froide.
Je cesse de fixer mon chronomètre. Je décroche mon sac à dos, je le dépose à côté de moi. Les larmes montent. Je m’assoie par terre, lourdement. C’est fini pour moi. J’en veux à mon corps qui ne va encore pas assez vite, malgré tous les efforts de ces derniers mois. Je ressens des émotions violentes qui poussent ma petite voix intérieure à répéter que je suis “nulle, nulle, nulle” et la sensation que je n’y arriverai jamais. Un sentiment d’échec cuisant.
Les premières émotions passées, je suis redescendue jusqu’au point de départ de l’examen probatoire. Tout le long, j’ai continué à pleurer. Et j’ai continué à pleurer après, jusqu’à la fin de la journée et mon retour à Toulouse.
Résultat des courses ? Un mal de crâne, une mauvaise nuit, des ruminations ; pas de doute : un échec à ma première tentative de l’examen probatoire Accompagnateurice Moyenne Montagne.
Malgré tout, ce qui m’aide à rebondir vient du fait que je tire une grosse fierté de mon parcours des derniers mois (et années, en réalité). On me dit que je suis “résiliente” face à l’échec.
J’ai aussi la sensation d’avoir avancé à une vitesse grand V, d’avoir compris, d’être plus en paix, d’avoir enfin fait la rencontre de celle que je suis vraiment. Je sais mieux ce dont j’ai besoin, ce que je suis, ce qui me définit. Je sais aussi ce que je veux pour mon futur. Tout ça, c’est lié à des décisions (quitter Paris par exemple, lol), c’est un changement de vie, c’est une thérapie psy, ce sont de nouvelles rencontres, beaucoup de réflexions intérieures.
Pourtant, tout cela se confronte brutalement au reste de mes convictions éthiques et politiques, l’écologie radicale et collective.
Je voudrais revenir sur cette première expérience. Sur sa préparation et ce qui découle de ce premier échec. Qu’est-ce que l’échec nous apprend ? Est-ce que l’échec nous apprend-t-il seulement quelque-chose ? Pourquoi j’ai activé, avant et après, des méthodes inspirées du développement personnel ? Et dans ma préparation sportive, comment jongler entre ces valeurs de performance et de compétition inhérente à ma pratique ?
Est-ce que finalement je suis problématique ? Mes pratiques sont-elles problématiques ? Mais ces mêmes pratiques m’ont aidé à traverser la dépression, non ? Est-ce que je dois être fière de moi, de ce parcours ?
Le sport oui, mais qu’en est-il de ses valeurs de compétition et de performance ? La montagne, plus que oui, mais que penser de ses pratiques parfois élitistes ? Et enfin, toute cette littérature, cette thérapie TCC (souvent très proche de la mouvance du développement personnel), et ces réflexions ne sont-elles pas le pur fruit du développement personnel qui incite les individus à se recentrer sur eux-mêmes, quitte à oublier toute forme d’organisation collective, d’empathie, d’entraide ?
Parfois, tout se mélange.

Captures de mes stories Instagram
Du sport comme thérapie, à la recherche de la performance
Avec 10 à 20% de réussite au probatoire, j’ai voulu mettre toutes les chances de mon côté. J’ai commencé à faire beaucoup de sport. Un plan d’entraînement précis avec des objectifs intermédiaires (qui se révèleront être 2 courses de trail).
Cette intensification du sport s’est calquée sur une temporalité particulière : une bonne phase de dépression. Oui, je crois que le sport a été un outil de thérapie complémentaire aux médicaments et à la thérapie avec ma psy. Courir, c’est un moment à moi, pour moi, où j’évacue les tensions, les pensées noires, où je lutte, où je me reconnecte avec mon corps, où je me sens vivante et plus forte.
Pourtant, je n’ai de cesse de ressentir une forte dissonance cognitive. Le sport n’est-il pas le lieu par excellence de violences ? La compétition, le culte voué à des champions, des héros, des guerriers ?
La doctrine du sport, celle du néolibéralisme ?
Les valeurs du sport sont celles empruntées à une mythologie guerrière, en témoigne l’ “essai sur la doctrine du sport” élaboré sous l’égide de Maurice Herzog. Alors nommé secrétaire d’Etat aux sports en 1963, il liste les principes de ce qu’il considère comme l’idéal du sport :
“Toute activité physique à caractère de jeu, qui prend la forme d’une lutte avec soi-même ou d’une compétition avec les autres, est un sport. Si cette activité oppose à autrui, elle doit toujours se pratiquer dans un esprit loyal et chevaleresque. Il ne peut y avoir de sport sans fair-play.”
Plus loin dans le document, on y trouve d’autres mots-clés qui renvoient au monde de l’entreprise : on attend du sportif·ve un “goût de l’initiative et des responsabilités”, qu’iel puisse “se dépasser” ou d’ “augmenter son efficacité”.
La pratique sportive ne s’est pas arrêtée en 1963, et ces valeurs sont toujours d’actualité. Il suffit d’observer les adjectifs utilisés pour qualifier l’héroïsme d’un Léon Marchand ou d’un Antoine Dupont.
Dépassement de soi et goût du risque
La “mythologie sportive” est sans cesse réinventée, à commencer par le récent documentaire Kaizen qui a fait couler beaucoup d’encre.
Arthur Malé, doctorant en STAPS spécialisé en histoire du sport, rappelle pourtant que “le sport n’est pas intrinsèquement porteur de valeurs, il est le réceptacle des usages qui en sont faits. Morale de l’effort, persévérance, dépassement de soi, goût du risque et culte de la performance trouvent dans le monde du sport et de l’entreprise un terreau fertile.”
Kaizen utilise tous les codes d’un mode viril, guerrier, entreprenant et glorifiant.
Le message inspirant dont Inoxtag se veut le promoteur sacralise les notions de réussite et d’effort, qui, à elles seules expliqueraient le succès d’un individu. En incarnant la preuve par l’exemple, Inoxtag personnifie ce système dans lequel le dépassement de soi est érigé en valeur suprême. Les séquences consacrées à la préparation physique valorisent un idéal dominé par la dramaturgie et le dépassement sans fin : alimentation protéinée, réveils matinaux, frappe dans un sac de boxe, courir aux aurores comme Rocky Balboa, etc.
Toujours selon Arthur Malé, le documentaire d’Inoxtag est un pur produit de notre culture du sport teintée d’une morale héritée des années 1960 : le sport nous rendrait meilleur·es, plus pur·es et sain·es.
Un “No pain, no gain” érigé en une véritable morale.
Pourtant, le professeur Jean-François Toussaint nous rappelle que cette volonté de dépassement, de repousser les limites de son corps, n’est pas plus réaliste que l’idéologie capitaliste qui consiste à croire que le marché est illimité. Le corps a ses limites, notre chère Terre également.
L’élitisme dans le sport
J’en parlais dans mon édition sur la montagne excluante, l’alpinisme est un haut lieu d’élitisme. Depuis la rédaction de cet article, j’ai lu Alpinisme & Anarchisme de Guillaume Goutte, où j’ai appris une autre version de l’Histoire de l’alpinisme. Celui, plus ouvrier et populaire, qui a permis l’ouverture des premières salles d’escalade associatives. On est, à l’époque, très loin des franchises de salles d’escalade que nous connaissons bien et qui nous demandent souvent pas moins de 15€ pour son entrée.
C’est aussi le constat réalisé par Emmanuelle Bonnet Oulaldj, présidente de la FSGT (qui fête ses 90 ans d’existence cette année) : “A partir de la fin du 19e siècle, le sport ouvrier a émergé fortement comme une réappropriation de leurs corps, non plus comme un prolongement de la machine, mais comme un moyen de s’émanciper du travail”. Elle regrette ainsi que les infrastructures publiques sportives ont en moyenne plus de 40 ans, sont peu rénovées alors que les salles de sport privées sont pléthore et contribuent à rendre toujours plus élitiste l’accès au sport.
Un esprit sain dans un corps sain, comment le sport renforce les codes du développement personnel
Dans “Le sport est-il si bon que ça pour la santé ?”, on entend Carl Cederström contribue également à rendre le sport utile au développement personnel. Il y a une logique d’efficacité. Aujourd’hui, le sport est érigé en injonction pour être en bonne santé physique et mentale.
Méditation, introspection et visualisation mentale
J’ai une amie proche qui, après avoir traversé des moments difficiles, s’est tournée vers le yoga, la méditation de pleine conscience et des lectures qu’on pourrait ranger sous l’étiquette de “développement personnel”. À chaque fois, je lui fais part de ma méfiance à l’égard de ces approches, notamment celles des 4 accords toltèques ou d'autres philosophies similaires, une méfiance renforcée après avoir lu Happycratie : Comment l’industrie du bonheur a pris le contrôle de nos vies d’Eva Illouz et Edgar Cabanas.
Cependant, je reste ouverte à ce qu’elle me propose. Cette amie est un peu mon modèle de vie, mon modèle de sagesse, de “résilience”. Je l’admire pour sa force, sa curiosité sans fin, sa qualité d’écoute et sa bienveillance infinie. Alors moi aussi, je m’y mets.
D’abord parce que ces techniques m’aident à continuer mon travail d’introspection personnelle, mais aussi pour m’aider à préparer le probatoire.
2 semaines avant l’examen : j’ai commencé à écouter des méditations guidées et des exercices de visualisation mentale.
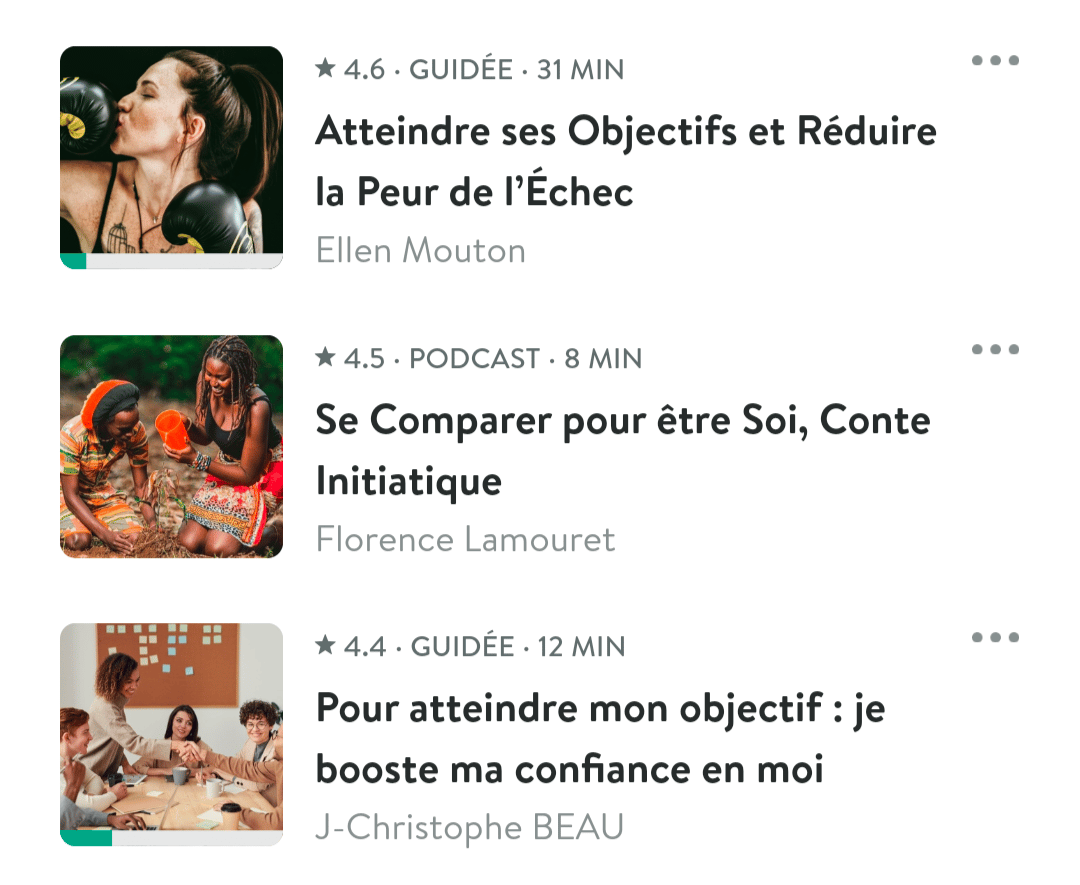
Capture de Insight Timer, l’app que j’utilise pour la méditation
Après le probatoire, il s’est agit de gérer mon échec.
Là encore, et de manière très similaire à mon rapport au sport, je ne sais sur quel pied danser.
Je suis suivie par une psychologue spécialisée en TCC, j’ai déjà fait des séances d’EMDR, et je suis ouverte à l’hypnose, au yoga, ainsi qu’à la méditation. Je suis prête à essayer tout ce qui peut m’apporter du bien-être. Pourtant, je ne peux m’empêcher de ressentir un profond dégoût pour tout ce que représente l’industrie du développement personnel. Le concept de résilience, qui semble pourtant pertinent face à l’échec ou au traumatisme, me laisse souvent sceptique.
A l’origine, des “cols blancs” disciplinés et productifs
Avant d’être la première porte d’entrée pour les dérives sectaires (plus de 1200 saisines selon la Miviludes en 2020), le développement personnel est arrivé en France par le biais des entreprises.
L’industrie du développement personnel s’est développé d’abord aux Etats-Unis pour s’importer en France par le biais des entreprises, c’est ce que nous apprend Eva Illouz et Edgar Cabanas dans Happycratie.
L’objectif ? Accroître les capacités individuelles des salariés (gestion du stress, communication, confiance en soi, etc) pour leur permettre d’intégrer au mieux les normes de l’entreprise et booster leur productivité.
En un sens et comme Elise Requilé le rappelle, le développement personnel en entreprise est “un facteur de normalisation des comportements des salariés, permettant un renforcement de l’ordre existant par le biais d’une euphémisation et d’une intériorisation des rapports de domination.”
En se concentrant sur des techniques de gestion du stress ou d’épanouissement du soi, les techniques de développement personnel délaissent le travail d’introspection psychologique sur le long-terme et l’analyse de facteurs exogènes (sociologiques, économiques, etc) pouvant expliquer des difficultés ressenties par l’individu.
“Même en nous livrant de façon rigoureuse à toutes les pratiques de bien-être qui existent sur cette planète, il est peu vraisemblable que, dans le monde qui est le nôtre, nous parvenions à atteindre un quelconque équilibre intégral grâce à ces pratiques, qui ne s’attaquent jamais à la racine du problème, voire, dans certains cas, l’entretiennent.”
Le développement personnel ne s’attaque pas à la racine du problème.
En réduisant nos problèmes à une perspective purement individuelle, on se prive d’une compréhension plus large et systémique. La littérature du développement personnel se présente souvent comme apolitique, mais en réalité, elle contribue à déresponsabiliser ceux qui détiennent le pouvoir — gouvernants, entreprises — et qui influencent les décisions impactant l’ensemble de la société.
Limiter notre compréhension au petit atome individuel permet d’effacer la responsabilité des détenteurs du pouvoir économique et politique qui agissent sur nous par le canal du droit, de la police, des lois et des réglementations.
Camille Teste reprend le concept psychologique de “contournement spirituel”, une sorte de mécanisme cognitif qui consiste à attribuer un problème matériel bien réel à une cause spirituelle vague, évitant ainsi de l'affronter directement.
Le développement personnel renforce l’idéologie néolibéraliste et le capitalisme.
Le secteur du développement personnel représente un marché colossal, évalué à 4 400 milliards de dollars à l’échelle mondiale, dont près de 133 milliards en France. Notre pays se positionne en 3e place en Europe, derrière l’Allemagne et l’Angleterre, et 6e au niveau mondial.
Dans ce contexte, on nous martèle jour et nuit que pour atteindre le bonheur, il faut constamment s’optimiser : mieux manger, bouger plus, rechercher un équilibre psychologique, corporel et spirituel. Derrière cette injonction, se cache un immense marché capitaliste qui prospère sur notre quête personnelle de perfection.
Camille Teste nous met en garde contre cette bienveillance apparente des coachs en développement personnel. Sous leurs conseils, elle rappelle que ces espaces de bien-être peuvent aussi servir de terrain de propagande, en véhiculant des idées qui déresponsabilisent les véritables acteurs du pouvoir économique et politique.
La philosophe Alenka Zupančič (citée par Camille Teste) appelle cette logique une “biomorale”. Ce concept désigne une morale qui renforce le mépris des classes dominantes envers les classes populaires. Un exemple frappant est la prolifération d’émissions de télévision où des personnes grosses tentent de maigrir, véhiculant l’idée que leur surpoids est entièrement de leur responsabilité individuelle. Ces personnes sont ainsi stigmatisées comme irresponsables et incapables de prendre soin d’elles-mêmes, sans qu’on prenne en compte les inégalités sociales et les traumatismes qu’elles ont pu subir.
Avez-vous entendu parler de la “loi de l’attraction” ? C’est une théorie issue du développement personnel qui prétend qu’il suffit de vouloir très fort quelque chose pour l’obtenir.
Cette focalisation sur la responsabilité individuelle alimente l’idée que nous sommes seul·es maîtres de notre sort, ce qui nous éloigne de plus en plus des solutions collectives.
“Sans cette culture du bien-être, qui sait, peut-être aurions-nous déjà fait la révolution.”
Résilience, symbole de la “bonne” victime
La résilience est, sans surprise, l’un des concepts les plus exploités par l’industrie du développement personnel. Nicolas Marquis, docteur en sociologie et auteur de nombreuses publications sur ce sujet, explore ce concept en profondeur :
On aurait bien tort de croire que le DP promeut la figure d’un être humain invincible. Au contraire, se retrouver au creux de la vague, même si ce n’est guère agréable, est plutôt considéré comme une bonne chose, car c’est face à l’adversité que nous nous révélons tels que nous sommes au-delà des faux-semblants (version romantique) et que nous puisons la force pour agir et rebondir (version efficace). C’est ce que met en avant la catégorie immensément populaire de « résilience » qui fait couler beaucoup d’encre tant en France (notamment avec Boris Cyrulnik) qu’aux États-Unis. Cette résilience est certes atteignable (elle aussi) par tous, mais ne s’obtient que si chacun décide non seulement d’agir sur ce qui lui arrive, mais aussi à partir de ce qui lui arrive (par exemple en témoignant, en produisant des œuvres d’art, etc.). Être résilient, c’est donc non seulement être actif face à sa souffrance, mais c’est aussi la rendre utile d’une façon ou d’une autre.
Le concept de résilience renvoie à l’idée d’être une “bonne victime”, celle qui parvient à transformer son traumatisme en opportunité. La notion d’utilité n’est pas anodine dans ce contexte ; elle s'inscrit pleinement dans les cultures néolibérales qui prévalent dans le domaine du développement personnel.
Déposséder les bourgeois de notre bien-être, pour la lutte collective
Alors que je sortais de mon probatoire, j’ai eu une véritable épiphanie en lisant l’article de Nicolas Framont sur Inoxtag :
Le “dépassement de soi” est devenu une valeur bourgeoise parce qu’elle est constamment activée par le management contemporain pour mettre sous pression les salariés et tirer d’eux le plus de productivité possible. Mais c’est une récupération injuste : le dépassement de soi est une caractéristique fondamentale de l’humanité, qui nous a permis de construire des sociétés plus justes et égalitaires.
Il ne s’agit plus de rejeter en bloc le développement personnel mais bien de se le réapproprier.
Si le développement personnel et les valeurs sportives comportent de nombreuses problématiques, je reste persuadée que ses pratiques en restent indispensables au bien-être individuel et collectif. Pour faire société.
D’abord, c’est indispensable pour continuer à vivre dans un monde violent qui mène à une perte de sens, des symptômes dépressifs, dévaluation de soi, comme le rappelle Elise Requilé. Un monde qui est violent pour les travailleureuses, pour les classes populaires, pour les minorisé·es, pour les femmes,… Bref.
Blâmer ce mouvement n’est pas plus utile à sa compréhension que s’en réjouir naïvement. Que le DP aide certains à vivre, il n’y a nullement lieu d’en douter. Est-il un instrument d’adaptation au système ou un moyen de faire bouger les lignes ? Sans doute les deux à la fois, mais encore faut-il savoir de quelles lignes on parle. Le DP est aussi un instrument qui porte une vision politique, même s’il s’en défend. À ce titre, et à moins que ses tenants ne se satisfassent d’être assimilés à de gentils distributeurs de pansements et de douces paroles en ces temps particulièrement durs, ce phénomène ne peut échapper à un examen, sans complaisance ni mépris, du monde dans lequel il veut inviter ses adeptes à vivre.
Mais on comprend bien vite que le bien-être individuel “des petits gestes” ne sert à pas grand chose pour notre société. Reconversion professionnelle, petits gestes écolos, quête de sens au travail, introspection intérieure ont peu d’impact tant le problème auquel on fait face est collectif, et non seulement individuel.
Prendre soin de soi et des autres pour lutter collectivement
C’est la thèse que défend Camille Teste (et à laquelle j’adhère) : le milieu militant est pollué d’une idéalisation du sacrifice dans l’engagement, il faut être productif·ve pour avancer. Pourtant, il serait plutôt un frein menant au burn-out militant :
En vous occupant de vous-mêmes, non seulement vous déjouez ce rôle d’oppressé.e qu’on vous réserve, et faites donc déjà acte de résistance, mais vous préserverez aussi votre capacité à lutter : si vous vous brûlez, vous ne servirez plus à rien. Vos savoirs militants, vos compétences, vos idéaux et vos réseaux ne serviront plus à rien.
Il nous faut donc entreprendre une dépossession du discours des dominants sur le développement personnel. Il ne s’agit plus de s’auto-optimiser mais bien d’apprendre à s’écouter, RALENTIR, déployer du temps libre et cultiver ses amitiés, renforcer son rapport au monde. Je crois qu’en développement cette force intérieure, nous renforçons individuellement notre capacité à faire collectif. Avec les autres, les animaux humains ou non humains.
La célébration de nos individualités ne doit pas nécessairement être occultée ou associée à une notion morale négative. Il existe bel et bien des modes d’individualisation en opposition à ceux, uniformes et consensuels, que m’impose le capitalisme. Densifier mes aspirations profondes, m’extraire de l’appareil productif, déployer mon temps libre, cultiver mes amitiés, aller vers ce qui me rend puissant, être fier de mes singularités et aimer celles des autres sont autant de rapports au monde qui échappent encore, en grande partie, au cadre libéral.
Le bien-être pour l’émancipation des individus et le renforcement des luttes collectives
Mais alors comment réinventer notre rapport au bien-être ? Que garder ? Que jeter ?
Je voudrais résumer des idées glanées ça et là, mais surtout dans le livre de Camille Teste :
Reconnexion au corps et écoute des besoins : Les pratiques de bien-être devraient encourager à travailler avec le corps plutôt que contre lui, en valorisant l’écoute des sensations corporelles, trop souvent négligées dans une société qui dissocie les individus de leurs corps.
S’émanciper grâce aux pratiques de bien-être : Ces pratiques doivent libérer les individus des injonctions à la performance (minceur, beauté, productivité) et promouvoir un ralentissement, un retour à la douceur et à l'oisiveté, en opposition à la culture du productivisme.
Soin et solidarité : Les pratiques de bien-être peuvent contribuer à l’élaboration d’une société plus juste en cultivant le soin mutuel et la solidarité. En apprenant à écouter et prendre soin de soi, on devient plus à même d’agir avec compassion et force pour les autres, dans une perspective de lutte contre les systèmes de domination (patriarcat, capitalisme).
Rejet de la logique de performance : Il est essentiel de déloger le productivisme des corps et d’apprendre à valoriser le repos et le ralentissement, plutôt que la quête de toujours plus de performances physiques ou mentales.
Impact politique et social du bien-être : Le bien-être ne doit pas simplement viser un confort individuel, mais être conçu comme un moyen d’émancipation collective. Il peut jouer un rôle révolutionnaire en favorisant des liens solidaires, la vulnérabilité partagée, et en aidant à construire des corps et des esprits aptes à changer la société.
Dans une perspective révolutionnaire, nous devons revendiquer que nos pratiques ne servent pas le même projet de société qu’un bien-être néolibéral ou réactionnaire. Elles ne visent pas la préservation d’un statu quo. Elles visent une transformation profonde de notre société.
Le sport joue un rôle central dans cette démarche de soin et de développement personnel.
Dans l’épisode “Le sport peut-il changer ma vie ?” du podcast Encore heureux, Agathe Philbé déploie son accompagnement physique autour du mouvement. Il s’agit ici de développer les qualités motrices de son corps : la force, la souplesse, l’endurance, l’explosivité et la coordination. Elle propose aux participants de ses activités de co-construire la séance selon leurs besoins et leurs envies pour s’approprier son corps.
C’est également ce que défend Emmanuelle Bonnet Oulaldj, présidente de la Fédération sportive et gymnique du travail (FSGT) dans l’épisode “Le sport est-il un droit ?”. Elle met ainsi en avant la nécessité de contrer la privatisation des salles de sport où seuls les plus aisés peuvent se permettre de faire du sport, au dépit des infrastructures publiques qui manquent de financement. Pour elle, l’enjeu est de taille : entretenir ces infrastructures publiques c’est bien la possibilité d’avoir des espaces où chacun.e peut se créer et se réinventer. L’idée est aussi de contrer la tendance actuelle qui mènent à déplacer les responsabilités collectives sur les responsabilités individuelles : tu es responsable d’être en bonne santé, de pratiquer du sport.
A ce sujet, je recommande d’aller visionner cette vidéo qui montre l’engagement de la FSGT pour le droit au sport à toustes.

Capture vidéo FSGT
J’ai longtemps vu la course à pied comme une pratique néolibérale, mais mon regard a changé. Le philosophe et marathonien Guillaume Le Blanc soulève une question clé : comment exister dans un monde qui va trop vite ? Pour lui, courir est une façon de se reconnecter au monde. On s’y sent intégré, en lien avec le rythme de l’univers. 'On est au monde.'
En évoquant des expressions comme “je cours après le temps”, Guillaume Le Blanc souligne que la course à pied est aussi une leçon de ralentissement. Dans un monde où tout va toujours plus vite — entre vélos, voitures et avions — courir devient une manière de fuir cette frénésie. “On court pour ne plus avoir à courir.”
Réinventer notre rapport au bien-être implique de s’émanciper des injonctions néolibérales qui valorisent la performance au détriment du lien social. Il est temps de revendiquer un bien-être qui ne soit pas un simple outil d’adaptation au système, mais un véritable levier d’émancipation collective. En prenant soin de nous et des autres, en cultivant la solidarité et en renouant avec notre corps, nous pouvons non seulement renforcer nos luttes individuelles, mais aussi bâtir un avenir où le bien-être n’est pas un privilège, mais un droit partagé.
Ainsi, le défi qui nous attend est double : apprendre à nous écouter et à nous reconnecter, tout en nourrissant les solidarités nécessaires pour faire face aux inégalités et aux injustices qui persistent. En réappropriant le développement personnel, non pas comme une quête isolée de perfection, mais comme une démarche collective d’émancipation, nous pouvons construire un monde où chacun·e trouve sa place dans la lutte pour un avenir plus juste et solidaire.
Des news à lire par ci par là :
Les athlètes montagnard·es repensent l’imaginaire de leur engagement écologique - Lire l’article
Une station de ski ferme définitivement après 85 ans d’existence - Lire l’article
A Méribel, on rachète des refuges pour en faire des hôtels pour riches, emmenés l’été en 4x4 et l’hiver en motoneige. Tout ça, sur fond de potentielle corruption politique; on remercie la mairie et le bourgeois en chef - Lire l’article
Reply